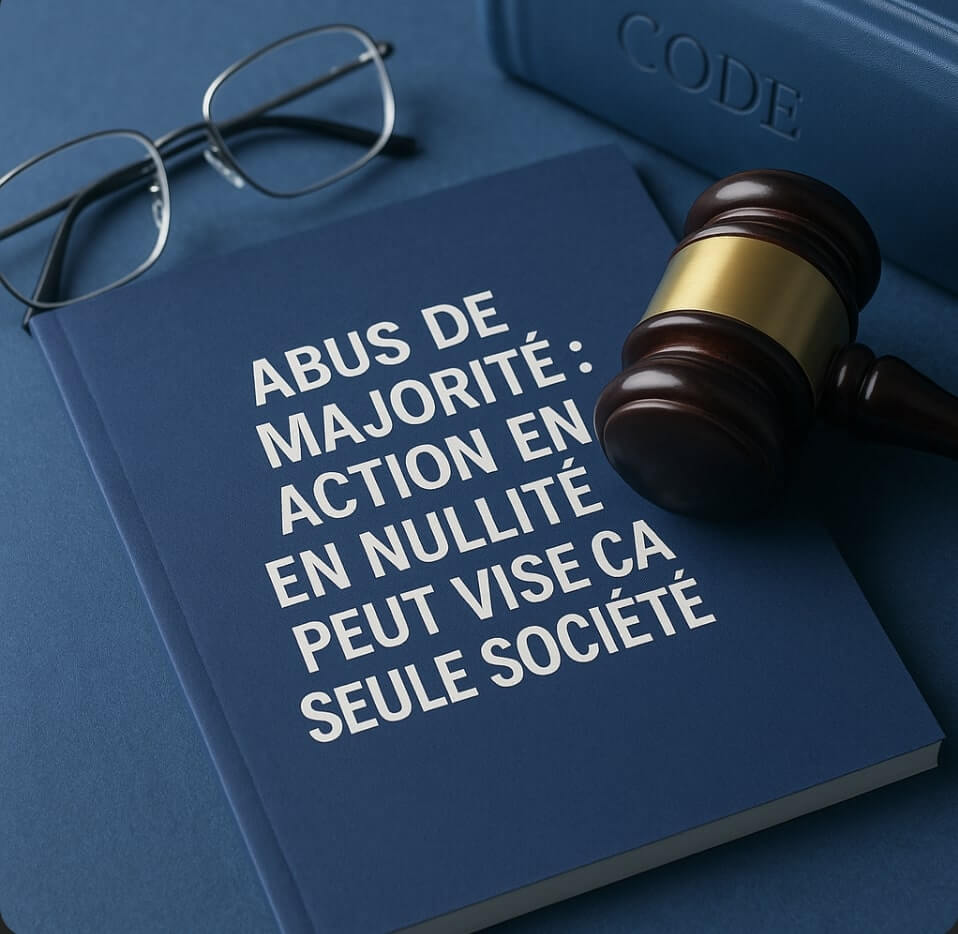L’essentiel à retenir sur l’action en nullité pour abus de majorité
- Recevabilité clarifiée : depuis l’arrêt du 9 juillet 2025, l’action en nullité pour abus de majorité peut être dirigée contre la seule société, sans mise en cause des majoritaires, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée.
- Distinction nette : la nullité vise la délibération collective et protège l’intérêt social, tandis que la responsabilité engage la faute personnelle des majoritaires.
- Conséquences procédurales : les minoritaires disposent désormais d’une voie d’action plus simple, moins coûteuse et juridiquement sécurisée lorsqu’ils recherchent uniquement l’annulation.
- Impact stratégique : en cas de cumul entre nullité et responsabilité, il devient nécessaire d’assigner à la fois la société et les majoritaires, ce qui implique une stratégie contentieuse adaptée.
L’abus de majorité constitue l’un des terrains les plus sensibles du droit des sociétés, car il cristallise les tensions entre associés majoritaires et minoritaires. En pratique, il survient lorsque la majorité utilise sa puissance de vote pour imposer des décisions contraires à l’intérêt social, dans le seul but de favoriser ses propres intérêts au détriment de la minorité.
Deux sanctions principales existent : l’action en nullité des délibérations et l’action en responsabilité civile des majoritaires. Mais une question procédurale restait discutée depuis des décennies : lors d’une action en nullité, fallait-il nécessairement mettre en cause les associés majoritaires, auteurs supposés de l’abus ?
Par un arrêt du 9 juillet 2025 (Cass. com., n° 23-23.484, publié au Bulletin), la Cour de cassation met fin à l’incertitude. Elle juge que l’action en nullité pour abus de majorité peut être dirigée contre la seule société, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’est formée contre les majoritaires.
Cette décision apporte une clarification précieuse pour les praticiens et les dirigeants. Pour en mesurer la portée, il convient d’abord de rappeler les contours de l’abus de majorité en assemblée générale, avant d’analyser le raisonnement de la Cour de cassation et ses implications stratégiques.
I. L’abus de majorité en assemblée générale : un équilibre entre pouvoir majoritaire et droits des minoritaires
A. Définition et conditions de l’abus de majorité
La jurisprudence a défini dès les années 1960 (Cass. com., 18 avr. 1961, n° 57-11.980) l’abus de majorité comme une décision qui :
- est contraire à l’intérêt social ;
- est adoptée dans le seul dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment de la minorité.
Ces deux conditions sont cumulatives. À défaut, la décision ne peut être annulée.
- L’intérêt social : il s’entend comme l’intérêt propre de la société en tant que personne morale, distinct de celui des associés. L’article 1833 du Code civil, modifié en 2019, précise désormais que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
- L’intention de nuire : la décision doit révéler un détournement manifeste du pouvoir majoritaire, adopté exclusivement pour avantager la majorité.
B. Exemples typiques d’abus de majorité
- Distribution excessive de dividendes asséchant la trésorerie, pour avantager les majoritaires.
- Refus systématique d’augmenter le capital pour empêcher la minorité de renforcer sa position.
- Décisions injustifiées visant à exclure les minoritaires de la gouvernance ou à réduire la valeur de leurs droits sociaux.
C. Distinction avec d’autres abus
- Abus d’égalité : lorsque la minorité bloque abusivement une décision dans le seul but de protéger ses intérêts.
- Abus de minorité : rare mais sanctionné, lorsqu’un petit groupe d’associés paralyse le fonctionnement social.
Dans le cas de l’abus de majorité, la sanction vise d’abord à rétablir le bon fonctionnement de la société et la protection des minoritaires.
II. Les sanctions de l’abus de majorité : nullité et responsabilité
A. L’action en nullité des délibérations
- Fondement : article 1844-10 du Code civil, qui prévoit l’annulation de toute décision contraire à la loi, aux statuts ou à l’intérêt social.
- Objet : obtenir l’annulation rétroactive de la décision collective litigieuse.
- Délai : trois ans à compter de la décision (art. 1844-14 C. civ.).
- Défendeur : la société, en tant que détentrice de la décision contestée.
B. L’action en responsabilité civile
- Fondement : article 1240 du Code civil (responsabilité délictuelle) ou article 1850 du Code civil pour les sociétés civiles.
- Objet : obtenir des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par la minorité.
- Délai : cinq ans (art. 2224 C. civ.).
- Défendeurs : les associés majoritaires eux-mêmes, auteurs de l’abus.
C. L’action mixte
Lorsque l’associé minoritaire demande à la fois l’annulation de la décision et l’octroi de dommages-intérêts, il doit assigner la société (pour la nullité) et les majoritaires (pour la responsabilité).
III. L’arrêt du 9 juillet 2025 : l’autonomie de l’action en nullité consacrée
A. Le litige porté devant la Cour de cassation
Dans l’affaire soumise à la Cour, des associés minoritaires d’un groupement foncier rural avaient demandé l’annulation de délibérations pour abus de majorité. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé leur action irrecevable, au motif que les majoritaires n’étaient pas assignés.
La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt : l’action en nullité n’impose pas la mise en cause des majoritaires dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’est dirigée contre eux.
B. Le raisonnement de la Haute juridiction
- Fondement textuel : combinaison de l’article 1844-10 du Code civil et de l’article 32 du Code de procédure civile.
- Principe dégagé : l’action en nullité vise la délibération en tant qu’acte collectif ; la société, détentrice de cet acte, est seule en mesure de se défendre.
- Conséquence : il n’y a pas lieu d’imposer la présence des majoritaires, sauf à rechercher leur responsabilité pécuniaire.
C. La rupture avec la jurisprudence antérieure
La cour d’appel de Versailles (1er févr. 2001, n° 00-2591) avait retenu la solution inverse, exigeant la présence des majoritaires. La Cour de cassation unifie désormais la pratique et consacre une autonomie procédurale de l’action en nullité.
IV. Conséquences pratiques et stratégiques pour les acteurs du droit des affaires
A. Pour les associés minoritaires
- Simplification procédurale : ils peuvent agir uniquement contre la société, sans multiplier les défendeurs.
- Réduction des coûts : procédure allégée, plus rapide et moins onéreuse.
- Renforcement de la protection : meilleure prévisibilité quant à la recevabilité de l’action.
B. Pour les associés majoritaires
- Limitation de l’exposition personnelle : leur responsabilité n’est engagée que si une indemnisation est sollicitée.
- Clarification des risques : distinction nette entre nullité (acte collectif) et responsabilité (faute individuelle).
C. Pour les dirigeants et chefs d’entreprise
- Sécurité juridique accrue : meilleure lisibilité des contentieux liés aux décisions collectives.
- Gestion proactive : nécessité d’anticiper les risques d’abus de majorité, notamment lors des assemblées sensibles.
- Dialogue renforcé avec les minoritaires : cet arrêt invite à privilégier la transparence et la concertation pour éviter des actions judiciaires.
- Affinement des stratégies contentieuses : choix entre nullité et responsabilité selon les objectifs du client.
- Gestion des délais : articulation entre la prescription triennale (nullité) et quinquennale (responsabilité).
- Optimisation des chances de succès : action calibrée selon la nature du préjudice et de l’intérêt social en cause.
L’arrêt du 9 juillet 2025 constitue une étape décisive dans le contentieux de l’abus de majorité. En consacrant l’autonomie de l’action en nullité, la Cour de cassation clarifie une incertitude ancienne et renforce la sécurité juridique.
- L’action en nullité pour abus de majorité est recevable contre la seule société.
- L’action en responsabilité suppose l’assignation des majoritaires.
- L’action mixte impose de mettre en cause à la fois la société et les associés majoritaires.
Au-delà de la technique procédurale, cette décision consacre une vision cohérente du droit des sociétés : l’intérêt social est le véritable pivot. Il appartient aux dirigeants, comme aux conseils, d’intégrer cette exigence dans la gouvernance des entreprises et dans les stratégies contentieuses.
En définitive, l’arrêt du 9 juillet 2025 apporte aux chefs d’entreprise comme aux praticiens une grille de lecture claire, leur permettant de sécuriser leurs assemblées générales et de mieux anticiper les risques d’abus de majorité.