Le Bouard Avocats

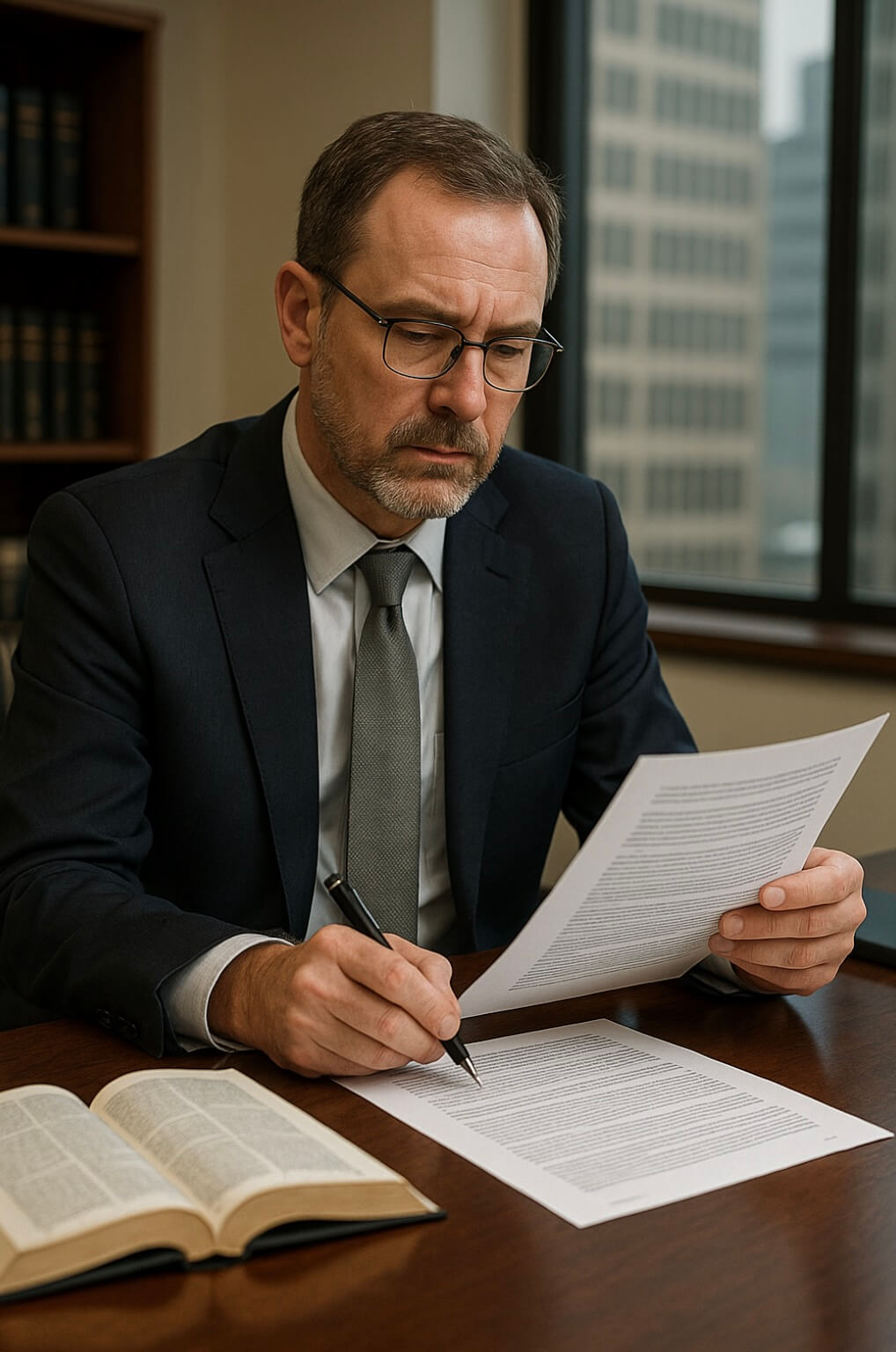
Lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société, la moindre irrégularité de la banque dans l’information annuelle peut avoir des conséquences importantes. L’arrêt du 18 juin 2025 de la Cour de cassation rappelle l’importance de cette obligation. Voici les points clés à retenir :
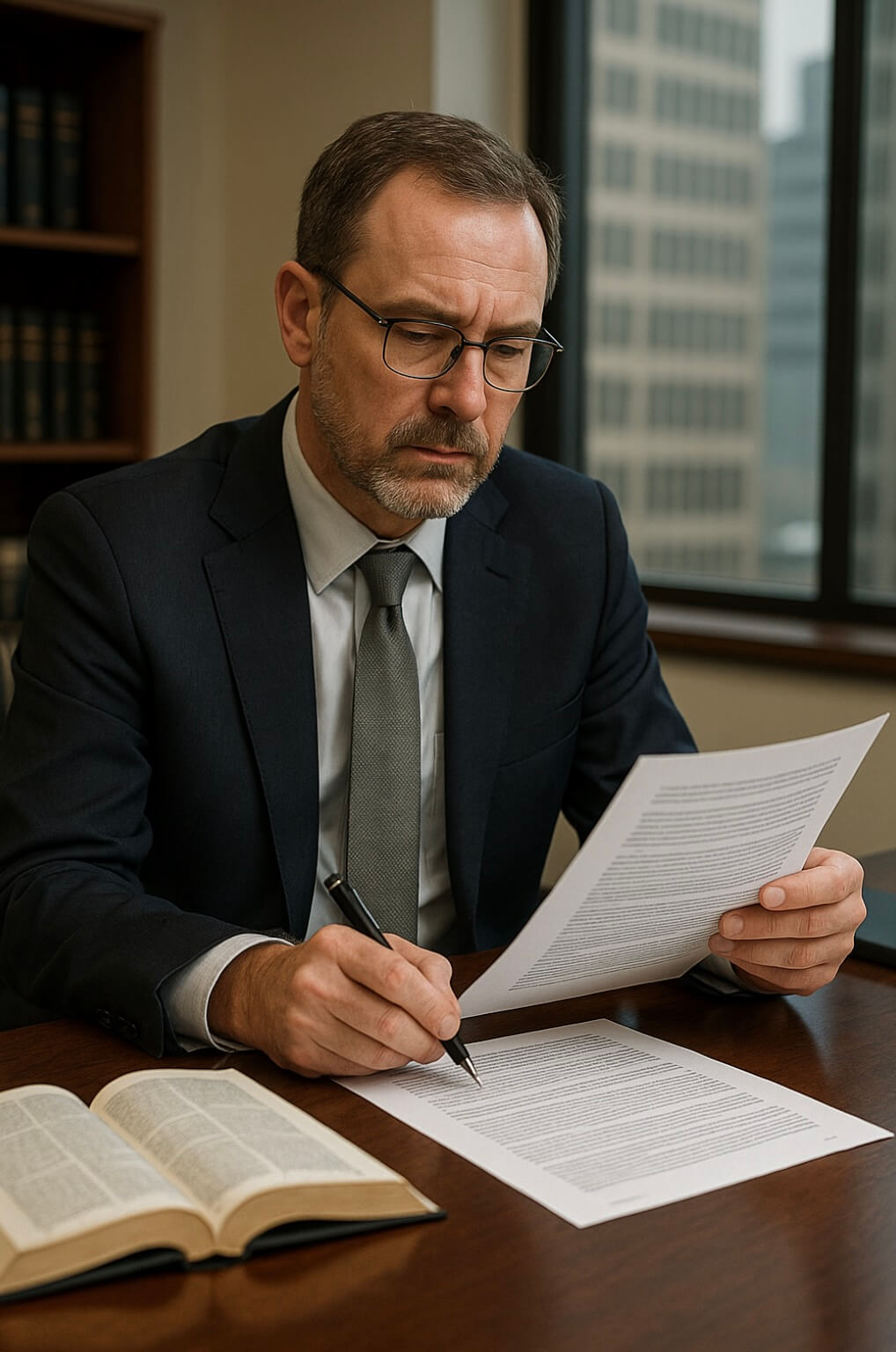
L’information annuelle de la caution constitue un dispositif essentiel de protection des dirigeants qui s’engagent à titre personnel pour garantir les dettes de leur société. Ce mécanisme, longtemps encadré par une pluralité de textes, a été unifié par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 juin 2025 (n° 23-14.713, publié au Bulletin) illustre toutefois que le contentieux demeure nourri et que les établissements bancaires doivent redoubler de vigilance.
La Haute juridiction rappelle en effet que la preuve de l’envoi de l’information annuelle doit être nominative et ne peut résulter d’un simple constat global d’huissier relatif à des envois groupés. Cette exigence a une portée pratique considérable pour les entreprises, en particulier leurs dirigeants souvent amenés à se porter caution des engagements sociaux.
Sous l’empire de l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier, applicable aux concours consentis par les établissements de crédit, la banque devait informer chaque caution, avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des accessoires dus au 31 décembre précédent. Le défaut de communication entraînait la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus depuis la précédente information jusqu’à la suivante.
La réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a abrogé ces dispositions spécifiques et a créé un régime unifié à l’article 2302 du Code civil. Désormais, le créancier professionnel doit délivrer une information annuelle à toute caution personne physique, quelle que soit la nature du créancier ou du concours. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, s’applique même aux cautionnements antérieurs, sauf contentieux déjà engagés.
L’objectif est de permettre à la caution, souvent dirigeant d’entreprise, de mesurer chaque année l’ampleur de son engagement. Elle peut ainsi adapter ses décisions patrimoniales et, le cas échéant, envisager de solliciter une renégociation ou de provisionner le risque. La sanction attachée au défaut d’information annuelle (déchéance du droit aux intérêts) démontre l’importance accordée à cette transparence.
Une banque consent un prêt à une société, garanti par le cautionnement de son dirigeant. La société étant mise en liquidation, la banque actionne la caution en paiement. Cette dernière oppose un manquement à l’obligation d’information annuelle et demande la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La banque produit des constats d’huissier établissant globalement que son prestataire procédait chaque année à l’envoi des lettres d’information. La cour d’appel considère cette preuve suffisante et condamne la caution.
La chambre commerciale casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle que le juge doit rechercher si le nom de la caution figure dans les listings d’envoi produits. À défaut, le constat d’huissier global ne suffit pas.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante : la preuve de l’information annuelle doit être rapportée individuellement pour chaque caution concernée. Elle ne peut résulter d’une attestation générale ou d’un constat attestant simplement du fonctionnement d’un dispositif d’envoi en masse.
En application du texte applicable aux faits (ancien art. L. 313-22 CMF), le défaut d’information entraîne la déchéance de la garantie des intérêts contractuels et des pénalités. Cette sanction est maintenue dans le régime actuel par l’article 2302 du Code civil, qui prévoit une perte du droit aux intérêts échus depuis la précédente information.
L’arrêt du 18 juin 2025 confirme que les établissements de crédit doivent conserver des preuves nominatives de l’envoi de l’information annuelle. À titre pratique, cela implique :
Le recours à un commissaire de justice pour constater des envois groupés ne dispense donc pas de produire un document nominatif.
La jurisprudence offre aux dirigeants cautions une arme efficace pour contester les intérêts réclamés par la banque. Si la preuve de l’information n’est pas rapportée individuellement, la caution est fondée à demander la déchéance du droit aux intérêts. Dans un contexte de difficulté financière, cet argument peut réduire considérablement la dette réclamée.
Il est recommandé aux dirigeants d’exiger, dès la signature de leur engagement de caution, que l’établissement précise les modalités de transmission et de conservation de l’information annuelle. En cas de litige ultérieur, cette précaution facilitera l’appréciation de la régularité de la preuve.
L’avocat en droit des affaires conseille le dirigeant au moment de la souscription de l’engagement. Il vérifie la proportionnalité de la caution (article 2300 du Code civil), sensibilise sur les risques patrimoniaux et alerte sur l’importance de l’information annuelle.
En cas d’action en exécution intentée par la banque, l’avocat de la caution dispose d’un argument stratégique : exiger la preuve individualisée de l’information annuelle. Si cette preuve fait défaut, la déchéance du droit aux intérêts pourra être obtenue, ce qui réduit significativement la dette due.
Pour les entreprises, la relation bancaire est un élément vital. L’avocat aide à trouver un équilibre entre protection du dirigeant caution et maintien de la confiance avec les créanciers. Il peut intervenir dans la négociation des contrats de financement, pour intégrer des modalités claires et sécurisées de respect de l’information annuelle.
L’arrêt du 18 juin 2025 confirme une tendance jurisprudentielle ferme : la preuve de l’information annuelle de la caution doit être individualisée. Les banques ne peuvent plus se contenter de constats d’envois groupés sans identification nominative.
Pour les dirigeants d’entreprise, souvent exposés en tant que cautions personnelles, cette exigence représente une garantie supplémentaire. Elle leur permet de contester le paiement des intérêts si la banque ne respecte pas scrupuleusement son obligation.
Anticiper et sécuriser ces aspects dès la conclusion des engagements financiers demeure essentiel. L’accompagnement d’un avocat, doté d’une expertise croisée en droit des affaires et en droit bancaire, constitue un atout déterminant pour protéger à la fois le dirigeant et l’entreprise.
Il s’agit de l’obligation pour la banque d’adresser chaque année à la caution un état de la dette garantie au 31 décembre précédent. L’objectif est d’assurer une transparence et de permettre à la caution d’évaluer le risque qu’elle supporte.
Non. La Cour de cassation a rappelé que la preuve doit être individualisée. Un constat attestant simplement de l’envoi de lettres ne suffit pas si le nom de la caution n’apparaît pas dans les listings d’expédition.
Le créancier est déchu de son droit aux intérêts et pénalités échus depuis la précédente information jusqu’à la communication effective de la nouvelle. Cette sanction est expressément prévue par l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier et reprise par l’article 2302 du Code civil.
Oui. L’article 2302 du Code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, s’applique depuis le 1er janvier 2022 à toutes les cautions personnes physiques, y compris celles souscrites avant cette date, sauf contentieux déjà en cours.
En cas de litige avec la banque, le dirigeant peut invoquer l’absence de preuve nominative pour demander la déchéance du droit aux intérêts. Cet argument peut réduire significativement la dette réclamée et constitue un levier stratégique de négociation.