Le Bouard Avocats

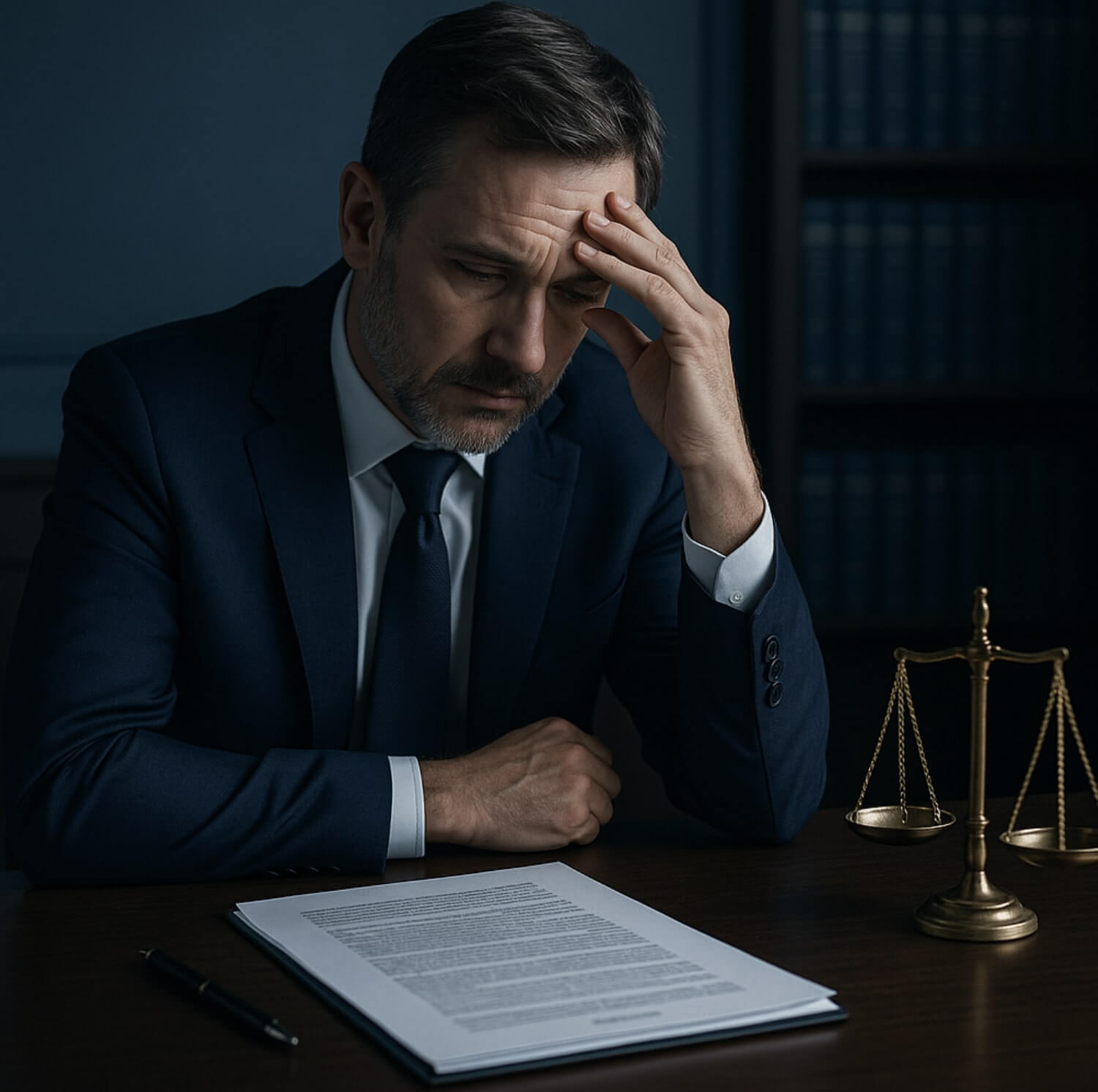
Avant d’aborder les détails de la décision rendue par la Cour de cassation le 11 septembre 2025 (Cass. 3e civ., n° 23-21.882), voici les principaux enseignements à retenir sur la notion de perte d’une chance d’obtenir un honoraire de résultat :

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2025 (Cass. 3e civ., n° 23-21.882, Sté Hermainvest c/ GRC Consulting), a rappelé un principe fondamental en matière de responsabilité contractuelle : lorsqu’un contrat prévoyant un honoraire de résultat est résilié avant son terme, la partie lésée ne peut prétendre à l’intégralité de la rémunération attendue. Seule la perte d’une chance d’obtenir cet honoraire peut donner lieu à indemnisation.
Cette décision, rendue sous l’empire de l’ancien article 1147 du Code civil (devenu article 1231-1), s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur la réparation intégrale du préjudice, et vient préciser la qualification juridique du dommage résultant de la rupture fautive d’un contrat à aléa.
Une société civile immobilière (SCI Hermainvest) avait conclu avec un prestataire spécialisé, la société GRC Consulting, une convention de gestion de sinistre relative à des désordres survenus lors de travaux d’agrandissement d’un immeuble.
Le contrat prévoyait une rémunération calculée à hauteur de 50 % des sommes versées par l’assureur dommages-ouvrage et les constructeurs, au-delà du coût des travaux de reprise.
Peu de temps après la signature, la SCI a décidé de résilier unilatéralement la convention, privant ainsi le prestataire de la possibilité d’obtenir l’honoraire de résultat stipulé.
Celui-ci a alors réclamé des dommages-intérêts équivalents au montant total des honoraires qu’il aurait perçus si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
La cour d’appel de Caen avait fait droit à cette demande, estimant qu’aucune incertitude ne pesait sur le versement de l’indemnité par l’assureur, la réalité des désordres et leur caractère décennal n’étant pas contestés.
La Cour de cassation censure cette position.
L’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147) énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit du retard dans l’exécution, à moins qu’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Ce texte fonde le principe de la réparation intégrale, selon lequel la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été exécuté, sans perte ni profit excessif.
Or, la Cour rappelle ici une distinction essentielle :
Ainsi, le préjudice lié à la résiliation anticipée d’un contrat à honoraire de résultat s’analyse comme une perte de chance, et non comme un gain manqué, dès lors que le montant de la rémunération dépend d’un événement aléatoire (ici, le montant de l’indemnisation versée par l’assureur).
Dans son arrêt du 11 septembre 2025, la troisième chambre civile juge que :
« Le préjudice résultant de la résiliation anticipée d’un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d’une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le cocontractant d’un honoraire de résultat, s’analyse en une perte de chance, laquelle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. »
La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir octroyé au prestataire une indemnité égale à la totalité de l’honoraire prévu, sans tenir compte du caractère incertain de sa perception.
Elle estime que l’assiette et le quantum de la rémunération dépendaient encore d’un aléa : l’issue exacte du protocole d’indemnisation n’était pas connue lors de la résiliation.
Le dommage devait donc être évalué proportionnellement à la probabilité de succès du prestataire dans l’exécution du contrat, et non sur la base du montant intégral de l’honoraire.
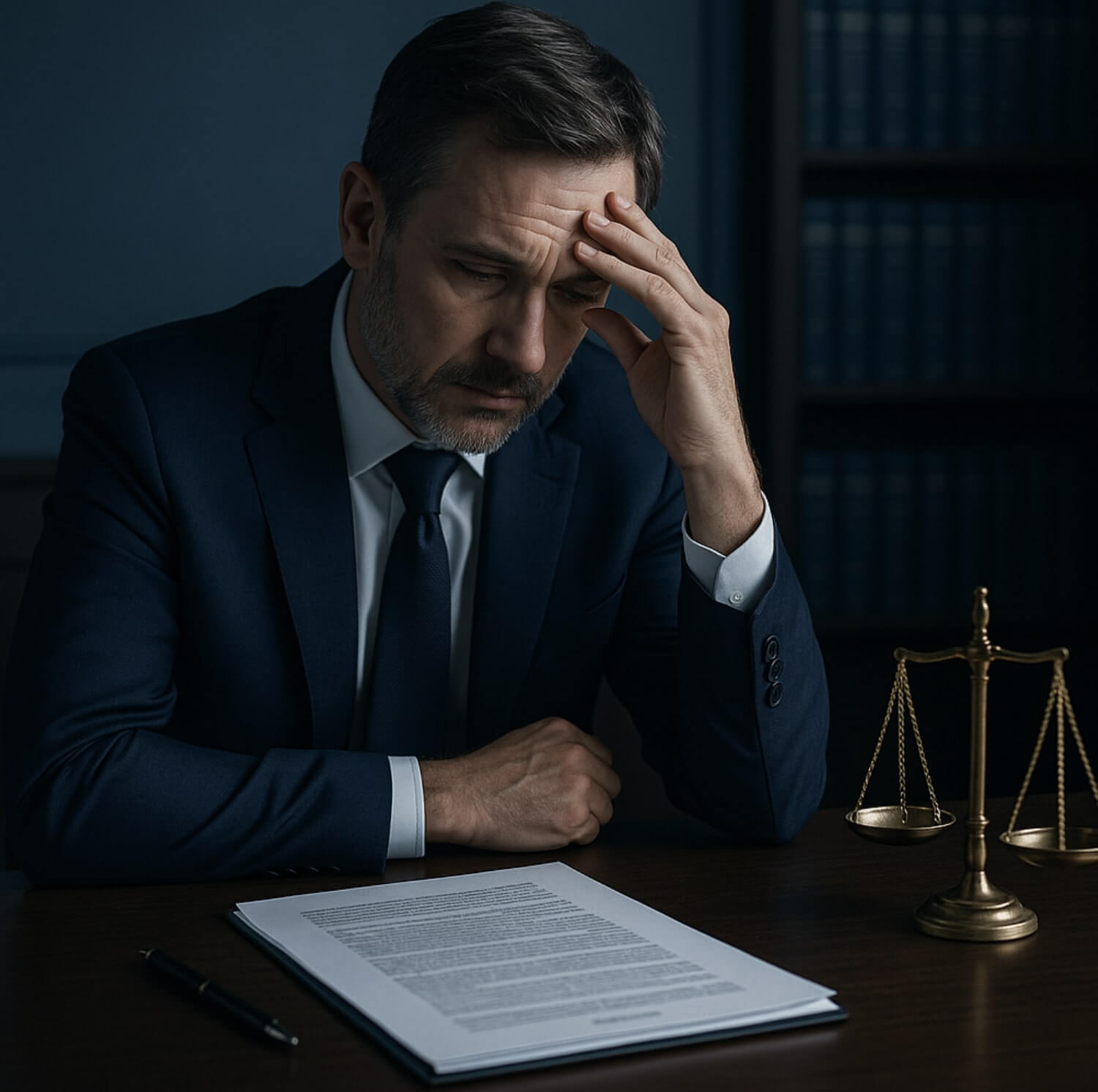
La perte de chance se définit comme « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 11-14.234).
Elle suppose l’existence d’un aléa réel, même limité. Le juge doit alors apprécier le préjudice non pas en fonction du résultat espéré, mais à hauteur de la chance perdue d’y parvenir.
Cette appréciation implique :
En d’autres termes, l’indemnisation ne peut jamais être égale à 100 % du gain attendu, sous peine de confondre perte de chance et gain manqué.
L’arrêt intéresse directement les contrats conclus avec des conseils, mandataires ou intermédiaires dont la rémunération dépend d’un résultat futur : avocats en droit des affaires à versailles, experts, cabinets de gestion de sinistres, agents commerciaux, etc.
En cas de rupture fautive du contrat avant la survenance du résultat convenu :
Cette distinction est essentielle pour éviter toute sur-indemnisation et respecter le principe d’équilibre contractuel.
Pour les acteurs économiques, cette décision appelle à une vigilance accrue lors de la rédaction et de la résiliation de contrats à honoraire variable.
Quelques recommandations pratiques peuvent être formulées :
Du côté des prestataires, il convient de démontrer que la chance perdue était sérieuse, réelle et objectivement mesurable, faute de quoi la demande pourrait être rejetée ou réduite.
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence fournie :
L’arrêt du 11 septembre 2025 confirme donc une lecture constante : la perte d’une chance constitue un préjudice autonome, mais dont la réparation doit rester proportionnée à la probabilité de réalisation du résultat manqué.
L’indemnisation de la perte d’une chance de percevoir un honoraire de résultat illustre la finesse de l’équilibre entre la liberté contractuelle et la rigueur de la réparation intégrale.
La Cour de cassation réaffirme que la victime d’une résiliation fautive ne peut se voir attribuer la totalité d’un gain aléatoire : seul le préjudice né de la disparition d’une opportunité sérieuse mérite réparation.
Pour les entreprises comme pour les professionnels du conseil, cette jurisprudence impose une approche prudente : la prévisibilité du résultat ne suffit pas à effacer l’aléa inhérent à tout contrat fondé sur la performance.
C’est à la mesure de cette chance perdue et d’elle seul que doit se calculer la juste indemnité.
La perte de chance désigne la disparition d’une opportunité favorable qui aurait pu se réaliser sans la faute de l’autre partie.
Elle constitue un préjudice certain, dès lors que la probabilité de succès était réelle et sérieuse. L’article 1231-1 du Code civil impose en effet que la réparation du préjudice replace la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été exécuté, sans pour autant lui procurer un enrichissement injustifié.
Ainsi, lorsque la rupture d’un contrat prive un prestataire de la possibilité d’obtenir un honoraire de résultat, la perte de chance ne peut être indemnisée qu’à proportion de la probabilité que cette rémunération se soit effectivement matérialisée.
Le gain manqué correspond à un avantage certain que la victime aurait nécessairement obtenu en l’absence de faute.
La perte de chance, quant à elle, suppose l’existence d’un aléa : la réalisation du gain espéré demeurait incertaine.
Dans la pratique, cette distinction a des conséquences majeures sur l’évaluation du préjudice. La réparation du gain manqué conduit à une indemnisation intégrale, tandis que la perte de chance est mesurée à la chance perdue. Autrement dit, plus la probabilité de succès était élevée, plus le montant de l’indemnisation sera important, mais jamais égal à 100 % de la rémunération espérée.
Dans l’arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation souligne que les honoraires de résultat étaient subordonnés à un événement futur : le versement d’indemnités par un assureur dommages-ouvrage.
Même si la réussite de la procédure paraissait probable, le montant précis de la rémunération restait incertain au moment de la résiliation du contrat.
La Haute juridiction rappelle que le préjudice subi par le prestataire ne résidait pas dans la perte d’un gain certain, mais dans la disparition d’une chance sérieuse d’obtenir cet honoraire.
Cette approche évite toute surévaluation du dommage et garantit la cohérence du principe de réparation intégrale.
L’évaluation de la perte de chance relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Elle suppose une analyse concrète de la situation au moment de la rupture du contrat :
Le juge doit ensuite quantifier la chance perdue en pourcentage et appliquer ce taux à la rémunération potentielle. Par exemple, si la probabilité de percevoir l’honoraire est évaluée à 40 %, l’indemnité allouée correspondra à 40 % du montant prévu.
Les entreprises et les prestataires peuvent prévenir ce type de contentieux en adoptant plusieurs réflexes contractuels :
Ces précautions permettent de sécuriser la relation contractuelle et de réduire l’incertitude liée à l’évaluation du préjudice, tout en protégeant les intérêts économiques des deux parties.